Pendant plus de 35 ans, le plus important des immeubles bordelais en bord de Garonne se trouvait dans le quartier de Bacalan, au nord de la ville. Il s'agissait de l'imposante Cité Lumineuse, qui s'élevait à l'endroit où se trouve aujourd'hui la station de bus et de tramway de Brandenburg. Quid de l'histoire de ce building et qu'est-il devenu ?
La zone environnante était autrefois le domaine viticole de Claveau, mais avec l'expansion de la ville de Bordeaux vers le nord au cours de la première moitié du XXe siècle, le quartier de Bacalan a pris forme, et était principalement composé de rues résidentielles constituées de maisons. Mais dans les années 1950, le maire de la ville, Jacques Chaban-Delmas, voyait les choses en grand et, à cette époque où la France connaissait une pénurie de logements, il considérait que l'avenir urbain était synonyme de cités et de buildings. C'est ainsi que sont nés des ensembles de logements sociaux tels que le Grand-Parc, la Cité de la Benauge, les Aubiers, ainsi que la refonte complète du quartier Mériadeck dans le centre-ville.
La Cité Lumineuse, propriété de la Ville, était le projet autonome le plus impressionnant de tous. Conçue par les architectes André Conte, Paul Daurel et Jean-Jacques Prévot, elle mesurait 200 mètres de long, 11 mètres de large, était haute de 15 étages, et comprenait 360 appartements étiquetés "LOGECO", pour "logements économiques et familiaux". À l'image du cours de la Garonne, la Cité s'incurvait doucement vers l'intérieur, son flanc oriental bénéficiant d'un point de vue idéal pour admirer le soleil levant... tandis que les couchers de soleil étaient évidemment appréciés depuis la façade occidentale !
 |
| L'histoire en photos aériennes. En haut : le terrain en 1950 avant la construction de la Cité Lumineuse, puis en 1976. En bas : la Cité en 1994, peu avant sa démolition (à noter, le terrain de foot situé près du fleuve), et la vue actuelle sur GoogleEarth. Les photos d'archives sont issues du site IGN Remonter le Temps. |
Les grands appartements de l'immeuble (de type F4 et F5), au nombre de 240, bénéficiaient du luxe relatif d'avoir une vue sur les deux côtés, un principe architectural guidé par la lumière du soleil (promu pour la première fois par Adolphe Augustin-Rey sous le nom d'"axe héliothermique") qui avait déjà été appliqué par l'influent architecte Le Corbusier à la Cité Radieuse de Marseille. La réutilisation de ce concept a, selon toute vraisemblance, inspiré le nom étrangement similaire de la Cité Lumineuse ; il n'existe aucune preuve concrète de cette hypothèse, mais c'est une théorie crédible que l'expert local Marc Saboya avance dans son livre "Chaban le bâtisseur".
La Cité Lumineuse a accueilli ses premiers résidents en 1960 et, au fil des ans, est devenue un lieu de vie cher à plusieurs milliers de personnes malgré ses nombreux défauts, comme l'absence de balcons (qui n'ont jamais fait partie du plan directeur afin de limiter les coûts) et le fait que - toujours selon Saboya - les cuisines et les salles de bains étaient minuscules et que les ascenseurs ne s'arrêtaient que tous les trois étages ! C'était également un lieu très animé. Entre le bâtiment et le fleuve, un terrain de football en sable avec des buts de taille règlementaire était le centre de gravité de nombreux jeunes du quartier. Pendant ce temps, les générations plus âgées se retrouvaient pour jouer à la pétanque sur les terrains voisins. Et la verdure tout autour était un endroit idyllique pour les événements en plein air tels que les pique-niques et les fêtes des résidents. De l'autre côté de l'immeuble, à partir de 1981, le parvis de la résidence accueillait le marché hebdomadaire de la Lumineuse, qui ne comptait au départ que quatre vendeurs mais qui s'est rapidement développé pour devenir un grand rendez-vous populaire.
 |
| Photo d'archives Sud Ouest du marché, et la même vue aujourd'hui. |
 |
| Clichés Sud Ouest des terrains de foot et de pétanque, et le même espace de nos jours. |
Cependant, les années 1980 n'ont pas été clémentes avec la Cité Lumineuse. Le bâtiment se détériorait à vue d’œil et les autorités locales estimaient que les travaux de réparation et de rénovation seraient plus coûteux que de démolir et de repartir à zéro. Bien que la décision de démolir le bâtiment n'allait être finalisée que plus tard, à partir du milieu des années 1980, chaque fois que des résidents quittaient les lieux, ils n'étaient pas remplacés et les appartements qu'ils lassaient étaient murés.
Le nombre décroissant de résidents encore sur place au début des années 1990 ont été activement encouragés à chercher ailleurs, la Ville facilitant les déménagements vers de nouveaux projets dans le domaine de la Cité Claveau à proximité ou dans des quartiers situés rive droite. À cette époque, la résidence n'était déjà plus que le fantôme de ce qu'elle avait été, et l'espace ouvert du rez-de-chaussée, notoirement venteux, étant devenu le territoire de dealers. Dire que le bâtiment était devenu inhospitalier serait un euphémisme, et au cours de l'été 1996, le dernier résident de la Cité Lumineuse, un monsieur de 83 ans du nom de M. San José, est parti pour de bon.
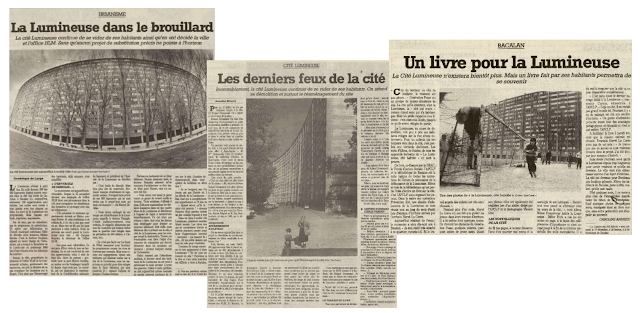 |
| Dans ses dernières années, le devenir de la Cité Lumineuse était un sujet récurrent dans le journal Sud Ouest. |
En septembre de la même année, les travaux de démolition ont commencé, mais leur progression a été entravée et retardée par la présence d'amiante. La tâche a également été rendue particulièrement difficile par la nécessité de couper un à un les sommets des 622 pieux qui avaient été utilisés pour les fondations du bâtiment, dans cette zone inévitablement humide et sujette aux inondations. Mais en février 1997, l'immeuble n'était plus, et les autorités locales ont commencé à se tourner vers l'avenir et le nouveau projet immobilier qui allait prendre sa place, comprenant 116 logements dans un environnement paysager de 2,5 hectares.
La mort lente de la Cité Lumineuse a inspiré de nombreux projets créatifs à l'époque, tels que des chansons écrites par le collectif rap local Génération Posse, et un livre, "La Lumineuse, cité habitée", compilant les écrits de plusieurs jeunes du quartier sous la direction de l'auteur à succès Hervé Le Corre, qui avait auparavant passé 17 ans dans le quartier de Bacalan à Bordeaux et avait gardé des liens forts avec le quartier et ses habitants... à tel point que Bacalan et la Cité Lumineuse figurent souvent en bonne place dans ses œuvres de fiction.
En rembobinant - ou plutôt en avançant rapidement - jusqu'en 2021, à part des souvenirs individuels et un peu de nostalgie, que reste-t-il de la Cité Lumineuse ? Eh bien, la réponse est... pour ainsi dire rien ! En prenant position en face du bureau de Poste et de la mairie de quartier dans le but de reproduire une photo repérée dans un numéro de 2013 d'un magazine local, ce qui frappe le plus est le vide absolu à la place du bâtiment.
 |
| Photo d'archive légèrement floue de la Cité Lumineuse avec la Poste et la Mairie de Quartier au premier plan, créditée à Labarthe et présentée dans un numéro de 2013 du magazine "Bacalan". Et, une fois encore, la même vue aujourd'hui. |
Mais quelques traces de l'époque de la Lumineuse sont encore visibles, même 25 ans plus tard. La première se trouve à quelques rues de là, sur la place Muscaillet, qui accueille désormais le Marché de la Lumineuse et ses camelots chaque vendredi matin. Malgré le passage du temps et quelques déménagements, le marché a symboliquement conservé son nom.
 |
| La Lumineuse s'affiche place Muscaillet. |
> Localiser sur la carte Invisible Bordeaux : Cité Lumineuse, rue Achard, Bordeaux.
> This article is also available in English!
> Source de la photo en haut de l'article : www.delcampe.net
> Merci à mon excellent ami Laurent B. pour ses tuyaux et ses souvenirs !

























































Suivre / contacter